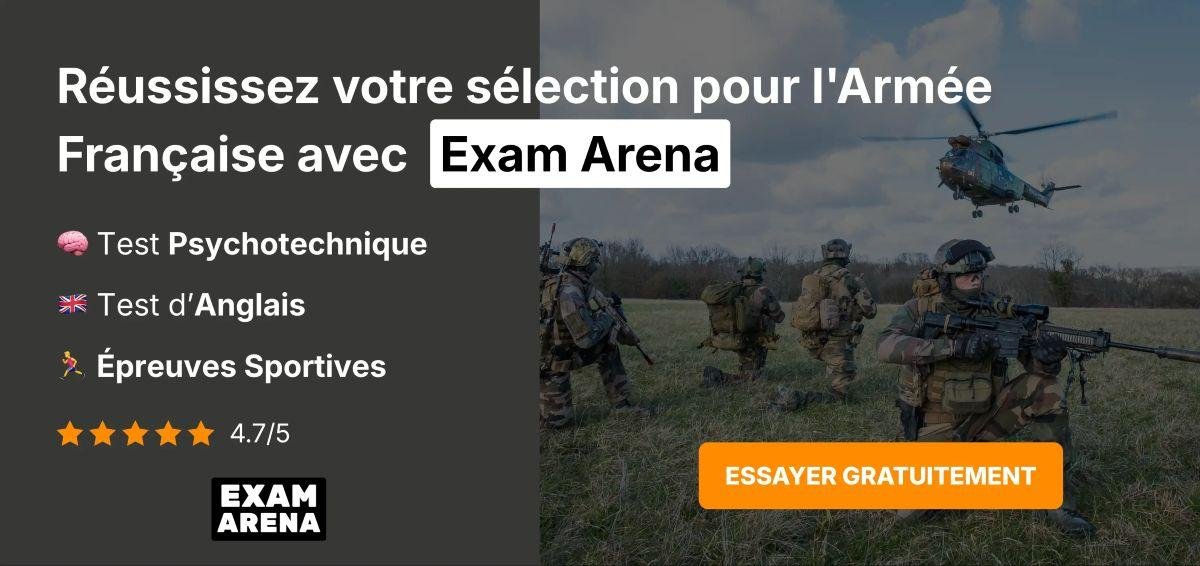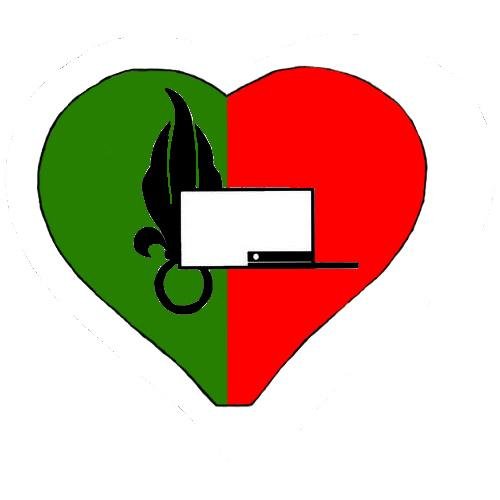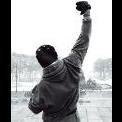-
Compteur de contenus
45 603 -
Inscription
-
Dernière visite
-
Jours gagnés
1 575
BTX a gagné pour la dernière fois le 9 février
BTX a eu le contenu le plus aimé !
À propos de BTX

- Actuellement Regarde l’accueil des forums
Contacts
- Adresse de votre site
Informations du profil
-
Sexe
Homme
-
Statut
Ancien militaire
-
Armée
Armée de Terre
Présentation
-
Votre présentation
Officier de l'armée de terre durant 35 ans dont 15 à la légion étrangère
BTX's Achievements
-
Bienvenue Lorrain d'origine pour être intéressé par le 54e RT ? Beau pays ! BTX
-
Sous peine de connaître bientôt les lois de l'apesanteur, avertissement gratuit pour absence de présentation. Une rubrique est dédiée à ce principe. BTX
-
A Dieu à notre "ami" malien ! BTX
-
Northrop Grumman fabrique les E-2D Advanced Hawkeye à St. Augustine, en Floride (Photo Northrop Grumman). C’était déjà un objectif de Pete Hegseth, le Secrétaire à la Guerre, qui avait diffusé le 7 novembre 2025 une note intitulée « Unifying the Department’s Arms Transfer and Security Cooperation Enterprise to Improve Efficiency and Enable Burden-Sharing« . Le 6 février 2026 a été publié un décret présidentiel sur « la nouvelle « stratégie américaine de transferts d’armes ». Ce décret présidentiel signé par Donald Trump, redéfinit le cadre des ventes d’armes à l’étranger et ne cache pas que l’objectif final est de consolider la BITD américaine avant tout. Il enjoint le gouvernement des États-Unis à privilégier les transferts d’armes « aux partenaires étrangers qui ont investi dans leur propre défense et leurs propres capacités, qui jouent un rôle ou occupent une position géographique essentielle dans les plans et les opérations des États-Unis, ou qui contribuent à la sécurité économique » des USA, indique le document qui poursuit: « Les États-Unis utiliseront les ventes et les transferts d’armes pour renforcer les activités d’acquisition et de maintien en condition opérationnelle du Pentagone, notamment en renforçant la résilience de la chaîne d’approvisionnement essentielle et en évitant d’accroître les retards de livraison des composants prioritaires et des produits finis qui ont une incidence sur la capacité opérationnelle des États-Unis, de leurs alliés et de leurs partenaires. » A cet effet, le Secrétaire à la Guerre, Pete Hegseth, et le Secrétaire d’État, Marco Rubio, ont 90 jours pour élaborer des critères clairs permettant de déterminer quelles armes et capacités nécessitent un suivi renforcé de leur utilisation finale. Dans les 120 jours suivant la proclamation du décret présidentiel, les deux chefs de Département, ainsi que le Secrétaire au Commerce, rédigeront « un catalogue des systèmes d’armes qui sont prioritaires »; les États-Unis encourageront leurs alliés et partenaires à acquérir ces systèmes. « Un groupe de travail sur la promotion des ventes militaires américaines sera ultérieurement mis en place afin d’élaborer un plan de mise en œuvre. » « La stratégie de transfert d’armes « America First » va désormais mobiliser plus de 300 milliards de dollars de ventes annuelles d’armements pour réindustrialiser stratégiquement les États-Unis et livrer rapidement des armes de fabrication américaine afin d’aider nos partenaires et alliés à renforcer la dissuasion et à se défendre », selon une Fact Sheet de la Maison Blanche. https://lignesdedefense.ouest-france.fr/la-nouvelle-strategie-americaine-de-transferts-darmes-faire-passer-des-commandes-darmes-us-aux-allies-pour-renforcer-la-bitd-des-usa/
-
Des Marsouins prennent la Flotte sur l’île de Ré https://x.com/pascalbtr/status/2020513447687950347?ref_src=twsrc^tfw|twcamp^tweetembed|twterm^2020513447687950347|twgr^96f815501d9037d369ff1db1283730e960cae977|twcon^s1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Flignesdedefense.ouest-france.fr%2Forion26-des-marsouins-prennent-la-flotte-sur-lile-de-re%2F Comme je l’écrivais ce dimanche matin, c’est sur l’île de Ré que les premières opérations amphibies de l’exercice ORION 26 ont eu lieu tout au long de la journée. Des éléments des unités de la 9e BIMa ont été débarqués du PHA Mistral. Les premiers véhicules incluaient des VBL et des AMX10-RC des troupes de marine, ainsi que des engins du génie fournis par le 1er régiment étranger du génie. Un poste de commandement a aussi été débarqué. Objectif de ce détachement: prendre le contrôle de La Flotte, au pied du pont qui relie l’île de Ré et le continent. Une phase d’héliportages a aussi eu lieu avec une demi-douzaine d’appareils transportant des éléments vers Rivedoux-Plage puis regagnant le PHA. A voir ici une vidéo mise enligne par C17 Infos. https://x.com/TrackeurADSB/status/2020505458986115187?ref_src=twsrc^tfw|twcamp^tweetembed|twterm^2020505458986115187|twgr^96f815501d9037d369ff1db1283730e960cae977|twcon^s1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Flignesdedefense.ouest-france.fr%2Forion26-des-marsouins-prennent-la-flotte-sur-lile-de-re%2F
-
https://lignesdedefense.ouest-france.fr/futur-porte-avions-francais-43-millions-de-plus-a-ga-pour-la-conception-et-le-developpement-des-catapultes/ Futur porte-avions français : 43 millions $ de plus à GA pour la conception et le développement des catapultes Lu dans la livraison de vendredi soir des avis d’attribution de marchés par le Pentagone, cette annonce concernant la société General Atomics et le contrat passé avec la France pour la fourniture des catapultes électro-magnétique pour le futur porte-avions tricolore: « General Atomics, San Diego, California, is awarded a $43,349,633 modification (P00002) to a firm-fixed-price, cost-plus-fixed-fee order (N0001925F0028) against a previously issued basic ordering agreement (N0001921G0014). This modification exercises options to provide continued advancement of the design and development of the future French carrier configuration of the Electromagnetic Aircraft Launch System and Advanced Arresting Gear through the critical design review, resulting in a configuration baseline being established as well as procures technical data to support the configuration. Work will be performed in San Diego, California (89%); Lakehurst, New Jersey (5.5%); Tupelo, Mississippi (3.5%); Boston, Massachusetts (1%); and Patuxent River, Maryland (1%), and is expected to be completed in January 2028. Foreign Military Sales customer funds in the amount of $43,349,633 will be obligated at the time of award, none of which will expire at the end of the current fiscal year. This order was not competed. Naval Air Systems Command, Patuxent River, Maryland, is the contracting activity. » On retiendra de cette annonce la phrase suivante (c’est moi qui soulignes): « Cette modification concerne les options permettant de poursuivre le développement et la conception de la future configuration du système de lancement électromagnétique d’aéronefs et du système d’arrêt avancé qui équipera le porte-avions français (…) aboutissant à l’établissement d’une configuration de référence et à l’acquisition de données techniques pour la réaliser. » Une question de souveraineté Cette annonce intervient alors que l’on s’interroge actuellement sur la pertinence du choix des EMALS et sur la possible trop grande dépendance à l’industrie américaine et sur le bon vouloir du versatile Donald Trump. Comme on pouvait le lire il y a quelques jours dans Theatrum Belli: « Le choix des catapultes électromagnétiques américaines apparaissait alors comme un compromis rationnel, permettant d’accéder à une capacité de pointe sans assumer les risques d’un développement national. Or, le contexte international a profondément évolué. » Effectivement, la dépendance industrielle et technologique est indéniable, notamment pour le MCO, les mises à jour logicielles, les algorithmes de contrôle et certaines capacités d’adaptation dans la durée. Et sur le plan politique, les risques ne sont pas négligeables. Risque 1: une interruption du programme américain d’équiper les PA avec de telles catapultes, ce qui isolerait le programme français et pourrait avoir une incidence sur la facture. On se souviendra que Trump, en tournée au Japon fin octobre 2025, a critiqué le système électromagnétique des catapultes de la nouvelle génération des porte-avions américains. Il souhaiterait un retour aux traditionnelles catapultes à vapeur. Et de conclure: « Sérieusement, je vais signer un décret : quand on construira des porte-avions, ce sera de la vapeur pour les catapultes et de l’hydraulique pour les ascenseurs. Nous n’aurons jamais de problème ». Pourtant, les avantages du système électromagnétique sont nombreux : il se recharge plus rapidement que des catapultes à vapeur, requiert moins de personnel et est plus silencieux. Risque 2: une interruption, voire annulation, de la commande par les USA en guise rétorsion si les désaccords franco-américains étaient trop nombreux et particulièrement vifs. Rappelons-nous qu’en 2003, lors du refus de la France de soutenir les États-Unis dans leur invasion de l’Irak au Conseil de sécurité des Nations unies, la Maison-Blanche a décidé d’interrompre la livraison de pièces détachées pour les catapultes à vapeur du Charles-de-Gaulle. Certes on n’en est pas là et l’avis de vendredi en témoigne. Mais la volatilité américaine n’est pas à sous-estimer.
-

La difficile mission de Serge Bavaud à la tête du SRC
BTX a posté un sujet dans Actualité sur les Forces de Sécurité
https://ainsi-va-le-monde.blogspot.com/2026/02/la-difficile-mission-de-serge-bavaud-la.html « La menace terroriste en Suisse est élevée » estimait le Service de renseignement de la Confédération dans son rapport 2025. Un chantier parmi de nombreux autres pour Serge Bavaud, son directeur depuis le 1er novembre dernier. Ce cinquantenaire, qui a été nommé à l’orée de l’été dernier ambassadeur de Berne en Algérie a finalement été retenu par le comité de sélection mandaté par le chef du département de la défense, de la protection de la population et des sports, Martin Pfister, pour diriger le SRC. Spécialiste de la politique de sécurité, il a occupé de nombreux postes au sein de son « ministère » de tutelle, le DDPS. Réforme contestée Ce Fribourgeois a franchi les portes d’un SRC qui fait face à de nombreux défis. A commencer par sa transformation tout en assurant ses missions au quotidien, initiée par son prédécesseur Christian Dussey, démissionnaire, qui a créé de fortes tensions avec le personnel et entrainé des départs. C. Dussey l’explique ainsi « C’est comme piloter un avion et modifier celui-ci tout en volant ». Cette réforme concerne notamment le périmètre de ses unités, le processus de travail et vise à moderniser le renseignement helvétique. Nombreux chantiers Le nouveau patron du service a donc pour objectif de rétablir la confiance avec ses nouveaux collaborateurs (plus de 400). « Une priorité pour le nouveau directeur » confirme Martin Pfister. Autre nécessité, obtenir une substantielle hausse des crédits pour faire face à des missions toujours plus nombreuses. Un autre point d’amélioration réside dans une reprise du dialogue avec les cantons. Le Conseil fédéral vient d’adopter une révision de la loi sur le renseignement afin d’améliorer « la détection précoce sur les menaces graves, l’extrémisme violent et les cyberattaques ». Le texte a été transmis au Parlement. Photo Serge Bavaud ©VBS-DDPS -
Reussis-le ! Finis 1er et major de ton stage. A la Légion, ce sera une preuve pour ton encadrement de ta motivation. Il ny a rien de difficile, c'est à ta portée. Le tout est de bosser. Prends des notes durant les cours, en salle comme sur le terrain. Bonne chance. Tu nous diras au terme des 4 mois où tu en es. BTX
-
Salut Heureusement que tu t'es présenté ! " Militaire à la Légion étrangère" = Légionnaire. C'est plus parlant ! Ton chef de section t'envoie suivre une formation technique de spécialité dans le domaine SIC (système d'information et de communication ou transmissions). Rien d'alarmant. Tu restes un Légionnaire combattant. Mais une fois formé, tu devras être capable de mettre en oeuvre les moyens de communication dont dispose ta section ou ta compagnie en métropole comme en OPEX. Je suppose que tu vas faire ce stage à la CIS du 4e Etranger à Castelnaudary ? BTX
-
Seul Le Grain détient la réponse.
-
Depuis qu’il est mis en œuvre par l’Aviation légère de l’armée de Terre [version TTH, pour Tactical Transport Helicopter] et la Marine nationale [NFH, pour Nato Frigate Helicopter], l’hélicoptère NH90 « Caïman » connaît des problèmes récurrents de disponibilité, au point que, quand elle était ministre des Armées, en janvier 2022, Florence Parly fit des remontrances à Airbus Helicopters, membre du consortium NHIndustries aux côtés de Leonardo et de Fokker. « Il ne suffit pas de concevoir, de construire et d’assembler des hélicoptères, car une fois sortis de l’usine encore faut-il les entretenir pour pouvoir les faire voler. […] J’attends donc de meilleurs résultats sur la disponibilité de cet hélicoptère et je continuerai à être très attentive à vos efforts en ce sens », avait-elle dit. Cela étant, grâce à la mise en place des contrats verticalisés par la Direction de la Maintenance aéronautique [DMAé], à l’homogénéisation des différents standards de la version NFH et à l’attribution d’un nouveau marché de soutien à NHIndustries, la disponibilité des NH90 s’est progressivement améliorée. Du moins, c’est ce qu’avait indiqué la Direction générale de l’armement [DGA] l’an passé. En effet, six mois après une réunion organisée avec Airbus Helicopters et les acteurs de l’entretien de ce type d’appareil, la DGA s’était félicitée d’une « amélioration de la disponibilité opérationnelle » des NH90 et du fait que les objectifs fixés en 2024 sur la « livraison des équipements entretenus » avaient été atteints. Cependant, il restait encore à « améliorer la fluidification de la chaîne logistique » et à « développer les capacités de diagnostic et de réparation au plus près des aéronefs ». A priori, la situation des NH90 de l’Aéronautique navale n’était pas totalement satisfaisante il y a encore quelques mois. Dans son dernier avis sur les crédits du programme 178 « Préparation des forces – Marine », le député Yannick Chenevard a en effet déploré que la disponibilité de ces appareils était encore « impactée par [leur] fort taux d’immobilisation malgré une amélioration constante » au cours de ces dernières années. Et cela à cause de « la persistance de tensions logistiques ». Afin d’y remédier, la DGA vient d’organiser une nouvelle « conférence des fournisseurs français du NH90 » pour les industriels et les utilisateurs de cet hélicoptère puissent avoir des « échanges directs ». « Dans le cadre d’une préparation aux conflits de haute intensité, plusieurs enjeux essentiels ont été abordés lors de cette rencontre », a fait savoir la DGA, via le réseau social LinkedIn, le 5 février. Et de citer la « réduction du nombre de pièces critiques pour la disponibilité, divisée par trois depuis 2023, avec un objectif à zéro en vue », des « actions pour améliorer la fiabilité des équipements » et le « renforcement du lien entre utilisateurs et industriels pour une meilleure connaissance des besoins ». Un plan de production a également été notifié aux industriels concernés pour 2026. « L’activité opérationnelle du NH90 est intimement liée à une connaissance optimale des besoins et possibilités de chacun, et chaque fournisseur ou acteur de la chaîne d’approvisionnement est essentiel dans la préparation à la haute intensité », a conclu la DGA. Photo : DGA https://www.opex360.com/2026/02/06/la-direction-generale-de-larmement-prepare-lhelicoptere-nh90-a-la-haute-intensite/
-
https://lignesdedefense.ouest-france.fr/les-chantiers-naval-piriou-ont-mis-a-leau-la-tete-de-serie-du-programme-de-sept-patrouilleurs-hauturiers/ Le jeudi 5 février, les chantier Piriou, de Concarneau, ont mis à l’eau le Trolley de Prévaux; il s’agit du premier d’une nouvelle génération de patrouilleurs hauturiers (PH) de 92 mètres et 2 400 tonnes. Voici ce qui est paru dans Ouest-France à ce sujet: Ce lancement marque le début du remplacement des anciens patrouilleurs de haute mer (PHM) et des patrouilleurs de service public (PSP) de la classe Flamant, qui seront progressivement désarmés d’ici 2027.
-
https://lignesdedefense.ouest-france.fr/orion-26-beachage-pres-de-toulon-avant-un-debarquement-sur-lile-de-re/ Beachage près de Toulon avant un débarquement sur l’île de Ré ©Nicolas Fernandez/Marine Nationale/Défense Mercredi 4 février 2026, le porte-hélicoptères amphibie (PHA) Tonnerre et la flottille amphibie réalisent un entraînement tactique amphibie (TACPHIB) pour qualifier les chauffeurs de véhicules des troupes de l’armée de Terre (126e RI), sur la plage de Cabasson (près de Toulon). ©Nicolas Fernandez/Marine Nationale/Défense Du 3 février au 1er mars 2026, se déroule la seconde phase de l’exercice interalliés et interarmées ORION 26 depuis la façade Atlantique de la France. Plusieurs unités de la Marine nationale, dont le groupe aéronaval Charles-de-Gaulle, renforcé par des moyens italiens et néerlandais, et un groupe amphibie avec deux PHA, ainsi que l’armée de Terre et l’armée de l’Air et de l’Espace, sont déployées au sein d’une coalition multinationale pour soutenir un pays fictif. La France y agit en tant que nation-cadre, à la demande de ses alliés et dans le respect de sa souveraineté, en coordination avec l’Otan. La deuxième phase d’exercice qui se déroule entre Brest et Saint-Nazaire, inclut la conquête de points d’entrée sur un territoire contesté, l’acquisition de la supériorité de la zone, puis des opérations amphibies et aéroportées qui permettront de maîtriser une zone de déploiement plus importante. Objectif l’île de Ré A noter que ce dimanche 8 et lundi 9 février, 120 militaires seront déployés à partir du PHA Mistral sur la plage de Sablanceaux à Rivedoux Plage, une plage de l’île de Ré à proximité du pont qui relie l’île au continent. Objectif des militaires: prendre le contrôle de La Flotte.
-
https://www.forcesoperations.com/un-nouveau-mecanisme-pour-massifier-la-flotte-francaise-de-mto/ Le ministère des Armées planche sur le lancement d’un nouveau mécanisme pour gagner en masse et en agilité sur les munitions téléopérées (MTO). Jusqu’à 240 000 vecteurs aériens pourraient ainsi être acquis au cours des prochaines années pour constituer autant de bases à de futures MTO. L’acquisition dynamique, voilà la procédure par laquelle la Direction générale de l’armement (DGA) va miser pour soutenir le développement et la production de trois catégories de vecteurs aériens destinés à être armés. La première emportera une tête militaire inférieure à 2 kg. La deuxième réunira des vecteurs capables d’intégrer une charge de 2 à 8 kg, quand la troisième réunira ceux, plus rares, capables d’aller au-delà. Les volumes envisagés dépassent, et de loin, les premières expériences menées dans ce segment. Après les 460 MTO Damoclès commandées au duo KNDS-Delair, les armées se doteraient de jusqu’à 180 000 vecteurs pour la seule première catégorie. Plus complexes à matérialiser, les deux autres segments se traduiraient par la livraison de jusqu’à 48 000 et 12 000 exemplaires. Lancé hier et désormais en phase d’appel à candidature, l’effort semble donc dissocier le porteur de la charge militaire. Le cas échéant, l’intégration ultérieure amènera sans doute à se pencher sur des questions de standardisation et de modularité. Il permettrait par ailleurs de gagner en agilité à l’heure où les cycles d’innovation progressent plus ou moins rapidement selon la brique visée. Voire – pure supposition – de réorienter plus facilement les vecteurs finalement non armés vers l’entraînement ou vers la recherche d’autres effets. La méthode adoptée par la DGA se veut innovante. Exit les appels d’offres à répétition, rigides et chronophages. Place à un cadre unique valide pour une durée de huit ans. À charge de la DGA d’y lancer autant de compétitions que nécessaire pour couvrir les besoins exprimés au fur et à mesure. Et à charge des dronistes de répondre à ces marchés spécifiques s’ils estiment leurs solutions pertinentes. En misant sur cette « compétition permanente », la DGA privilégie l’agilité pour mieux coller au foisonnement technologique du secteur. La DGA porte une attention toute particulière à l’origine et à l’industrialisation des systèmes proposés. Les MTO « relevant des intérêts essentiels de sécurité », seules les entreprises basées en France pourront en effet tenter leur chance. De même, les futurs marchés comporteront certaines règles « en matière de localisation des moyens et de sécurité d’approvisionnement ». Une fois démontrée l’empreinte tricolore, le champ se révèle plutôt ouvert. Tout acteur ou groupement intéressé devra démontrer un chiffre d’affaires annuel de 2 M€ ainsi que des capacités « reconnues » de développement et de production dans le domaine des drones, qu’il s’agisse du vecteur, de la station sol, des liaisons de données ou des logiciels embarqués. Des démonstrations potentiellement éliminatoires ne sont pas exclues en amont de la passation d’un contrat. Les premiers candidats sont attendus d’ici au 23 mars. Crédits image : armée de Terre / ADC Cédric B.
-
- 1
-